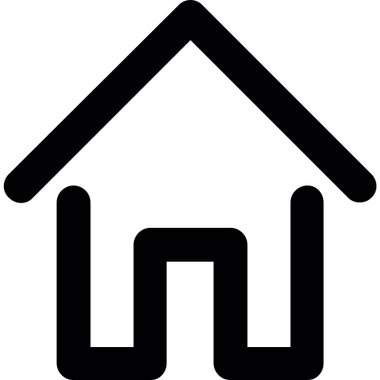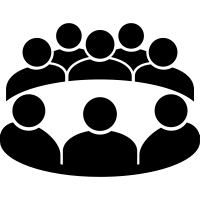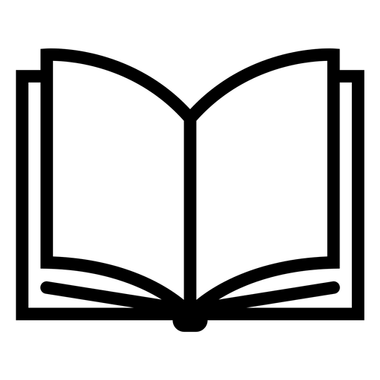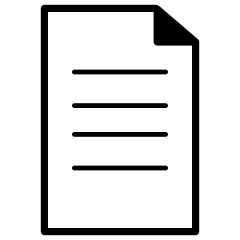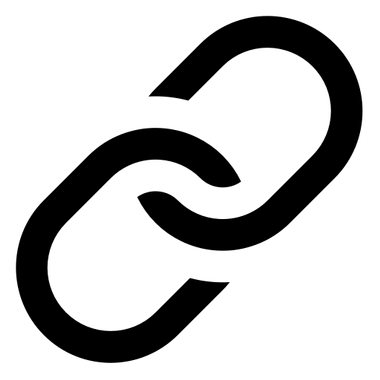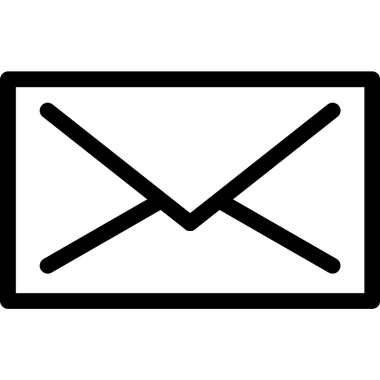|
Illusion antifasciste et réalité européenne par Francis-André Wollman et Bernard Wach |
Avril 2002 |
On assiste ces derniers jours à une mobilisation sans précédent contre la montée du fascisme, un vaste mouvement unissant les jeunes lycéens dans les rues de nos villes, les plumes les plus diverses et les plus autorisées dans les colonnes des journaux, les leaders politiques et syndicaux du haut de la tribune. Cela se passe en France en 2002 à l'issue du premier tour d'une élection présidentielle qui a montré, comme le rappelait Olivier Duhamel dans ces colonnes, une stabilité frappante du corps électoral depuis 1995. Mais cette fois-ci le candidat de gauche le mieux placé est dépassé par le candidat d'extrême-droite. Les Français se sont offert une élection présidentielle qui loin d'exprimer un vote pour celui ou celle qui serait le plus à même d'incarner la France dans le Monde pour les 5 ans à venir, est un vote de consommateurs mécontents de la puissance publique. Par delà la dispersion des voix de la droite et de la gauche républicaine, les électeurs-consommateurs ont porté leur choix sur des candidatures de témoignage dans un cas sur deux, sur un candidat fasciste dans 1 cas sur 5 mais aussi sur un candidat qui prône la révolution prolétarienne dans 1 cas sur 8.
Si la signification du vote Le Pen est abondamment commentée à longueur de tribunes, curieusement, l'électorat de gauche qui confond en 2002 la capacité à construire l'avenir du pays avec l'aptitude d'un candidat à préparer la révolution n'est l'objet d'aucune interrogation apparente. La gauche et son électorat aiment être au rendez-vous de l'Histoire. Nous avons assisté durant les 25 années de gaullisme et de modernisation de la droite française, à la lente reconstitution d'une gauche active capable d'infléchir le destin du pays comme l'avait fait le Front Populaire. Emerveillés au soir du 10 Mai 1981, nous avons vu le pouvoir « central » enfin basculer dans le camp du progrès social. Vingt ans de gestion des affaires publiques quasi-continue ont permis des changements significatifs de notre cadre de vie mais ces vingt ans n'ont pas modifié la culture politique de la gauche française. Alors, dans l'attente d'un second souffle historique qui n'est pas venu, nous serions brutalement confrontés à une histoire que nous n'attendions pas, la montée du fascisme. Paradoxalement, ce résultat du premier tour offrirait ainsi l'opportunité de renouer avec la tradition de l'Histoire soufflant à nos portes. L'entre-deux tours baigne dans les délices d'un antifascisme partagé qui redonnerait au pays ses lettres de noblesse. La France « se la joue » comme on dit aujourd'hui, manière 1930 sous l'il ahuri de nos voisins européens et de nos partenaires dans le monde. Jamais le constat que nous n'osons affronter le monde réel qui détermine notre avenir n'a été aussi patent depuis la montée, bien réelle celle-la du fascisme en Europe au milieu du siècle dernier. « No passaran » et « Nous vaincrons car nous sommes les plus forts » avant la défaite de 39-40 sonnent comme un écho assourdi par l'histoire de notre combat anti-fasciste de 2002, quand la France est menacée de quitter la scène politique internationale et son rôle moteur dans la construction européenne.
Car s'il y a un rendez-vous avec l'histoire, c'est bien sur le terrain européen qu'il se trouve et c'est là hélas que la gauche a brillé par son absence. La question de l'Europe, qui aurait dû être l'un des enjeux majeurs des présidentielles a été soigneusement mise de côté par les deux candidats principaux issus des formations parlementaires. La place de la France dans l'Europe et la force politique qu'aura ou non le vieux continent conditionnent pourtant notre prospérité et notre rayonnement dans le siècle qui s'annonce. Mais nos dirigeants n'ont pas eu le courage politique d'aider les français à comprendre qui ils sont et où ils vont dans les prochaines décennies. Quel candidat a rappelé à nos concitoyens que les conditions de vie de nos agriculteurs se sont améliorées parce que l'Europe a mis en place pendant plusieurs décennies une politique agricole commune ' Quel candidat a souligné qu'après l'effondrement du bloc soviétique, c'est par la construction d'une Europe politique que nous permettrons que le monde ne dépende pas de la seule volonté de la puissance américaine ' A force de nier la réalité des enjeux actuels du redéploiement de la politique française dans un cadre résolument européen, on encourage le corps électoral à vivre dans l'abstraction d'une scène politique franco-française où les acteurs nationaux, nos patrons et nos ouvriers, nos fascistes et nos révolutionnaires seraient l'horizon indépassable de notre histoire. Il est urgent que la gauche retrouve sa capacité à porter une vision politique embrassant plus large que les frontières héritées de Hugues Capet ! Oui il faut encourager le développement de syndicats européens et de partis trans-nationaux seuls à même de se battre pour une protection sociale respectueuse des aspirations des travailleurs, le renforcement d'associations de consommateurs européens mais aussi de chasseurs et d'écologistes européens, le rapprochement des structures d'enseignement à l'échelle européenne, et le combat pour une diplomatie et une défense européennes actives. Travail de longue haleine, mais qui est la vraie perspective du siècle.
Pour l'heure, nous n'avons d'autre choix que de porter à nouveau au pouvoir un homme, Jacques Chirac, discrédité par « les affaires », qui dans tout autre pays que le notre aurait été contraint de quitter ses fonctions. L'intégrité reconnue de Lionel Jospin ne lui a pas donné de crédit politique particulier. L'incapacité de la France à fournir un cadre réglementaire de probité pour ses dirigeants, à assurer les conditions minimums de sa respectabilité internationale est une des modalités de la perte des valeurs démocratique de beaucoup de nos concitoyens. L'illusion révolutionnaire, comme l'illusion néo-fasciste se nourrissent de cette conviction exprimée au premier tour que la démocratie républicaine en France, que son rôle dans le monde et en Europe n'était pas l'enjeu des présidentielles.
Souhaitons que par delà les commodités de l'antifascisme de l'entre-deux tours, la gauche en France réalise ce qui devrait distinguer à l'avenir une élection présidentielle d'une élection législative : la première fournit un cadre, la seconde l'enrichit de la diversité des sensibilités politiques, fussent-elles révolutionnaires ou fascistes. Oeuvrons pour que cette gauche à reconstruire ouvre enfin le débat politique lors des législatives de Juin. Que l'on évoque enfin la question européenne, les défis réels proposés à la vie économique et sociale dans notre pays, faisant la distinction entre service public et entreprise publique dans le cadre de l'accès indispensable des entreprises au marché mondial, que l'on parle de cette précarité du travail qui requiert une protection sociale repensée et qu'on ne s 'appuie plus sur des formules dont la clarté n'est qu'apparente comme « tolérance zéro » ou « zéro SDF ».
N'en déplaise à cette gauche sans perspective historique, il faut quitter les tréteaux hexagonaux et leur pantomime antifasciste qui nous emporte à l'écart des défis de ce siècle. Osons enfin le rêve européen comme un destin politique et social dans un continent qui a été le berceau des démocraties et le creuset des conquètes ouvrières.
Francis-André Wollman, biologiste, directeur de recherche au CNRS.
Bernard Wach, cadre d'entreprise
Vice-présidents de l'association ICE